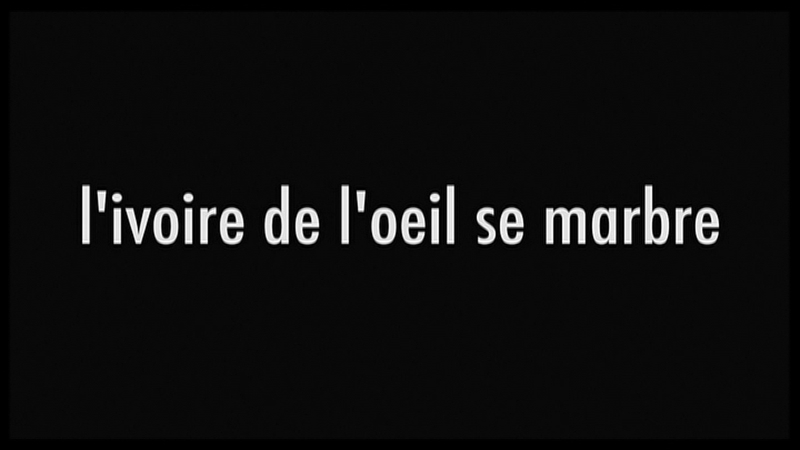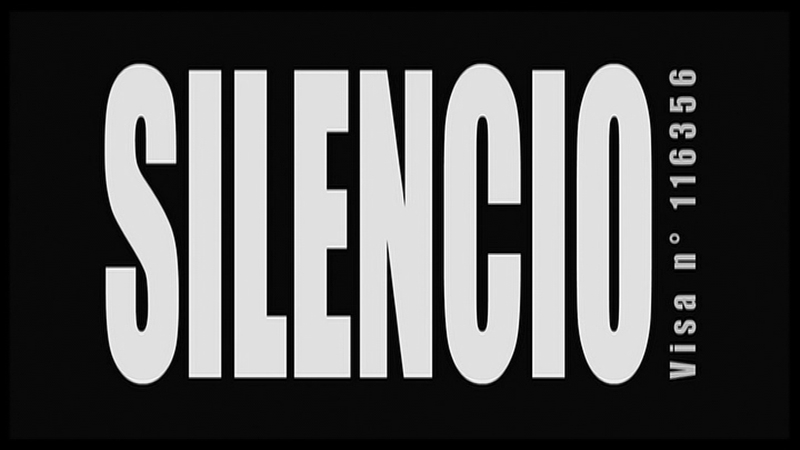En contrepoint à distal, Alexandre Thevenot propose cette vision du film de F.J. Ossang, Silencio, 2006 :
Film de paysages au faux air de rêverie expérimentale, Silencio qu’Ossang qualifie de « documentaire affectif […] tourné en une semaine, dans des conditions de lumière limite » [1] frappe par sa faculté d’épouser la matière et, avoisinant le procès de perception pure décrit par Bergson, d’en obtenir « une vision immédiate et instantanée » [2]. Une minute passe, un deuxième intertitre apparaît : « Le soleil brûle » ; souligne sa place centrale et périphérique, son aptitude à conjurer la peur du monde évanoui ou celle d’être aveuglé. Yeux dans le ciel, éclats du projecteur, contre-jours agressifs, scintillements, surexpositions, effets de coupe… Propulsé à x images par seconde, le blanc diffracté sur les photogrammes dicte le rythme du film et les paysages happés par le diaphragme trouvent une respiration que n’aurait pas reniée un Gilbert-Lecomte enivré de métaphysique expérimentale songeant au « désert du diaphragme éclairé au soleil alternatif bleu et rouge du cœur » [3]. Passionné par le « côté hypermatérialiste » et la « dimension alchimique » [4] du cinéma, Ossang renoue avec le devoir « d’apprendre à révéler la lumière » [5], mission intime que Brackhage corrélait à la vocation du cinéaste. Silencio saisit. L’irruption du soleil matérialise les palpitations du cœur, le silence du langage face à la mécanique des organes et, densifiant sa nature d’interstice, s’apparente à une « forme-absence », concept auquel Deleuze associait la faculté d’un écran noir ou blanc à valoir par lui-même, à ne plus avoir « une simple fonction de ponctuation, à la manière de l’enchaîné » mais « un rapport dialectique entre l’image et son absence » [6]. Revêtant cette fonction, les occurrences de blanc font que le spectateur ne reçoit pas le film passivement, comme un rappel descriptif du réel, c’est-à-dire comme « l’objet d’une pensée », mais activement, par un questionnement continu du visible, comme « un acte de pensée » ; elles substituent à l’expérience du temps celle de la matière et soustraient au film sa linéarité. Schefer pense le cinéma capable de faire « disparaître le monde en nous » de nous « efface[r] du monde d’un seul coup », qu’il est « une amputation sur nous-mêmes d’une partie du réel » [7]. Lointain écho de cette formule, faisant disparaître le film en lui, Silencio invite le spectateur à renouer avec l’immédiateté des sens et à confondre le présent et la lumière.
Silencio, 20′, 2006; musique: Throbbing Gristle
[1] Le Quotidien, n°5, Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, 2007, p. 2.
[2] Henri Bergson, Matière et mémoire : essai sur la relation du corps à l’esprit, PuF, 1939 [1990], p. 31.
[3] Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes I, Gallimard, 1974, p. 169.
[4] Vertigo, n° 42, printemps 2012, p. 114.
[5] Eline Grignard, « Le vitrail comme dispositif ornemental dans The Prisoner’s Cinema de Melvin Moti », 2013.
[6] Gilles Deleuze, L’Image-temps, Les Éditions de Minuit, 1985, p. 260.
[7] Jean-Louis Schefer, L’Homme ordinaire du cinéma, Gallimard, 1980, p. 128.
[cliquer pour faire défiler quelques photogrammes du film :]